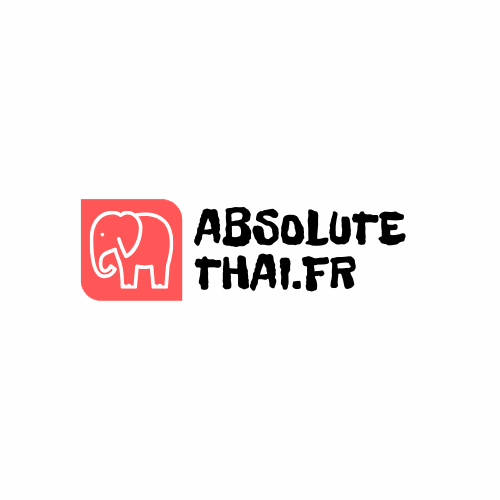L’empreinte croisée des styles Lanna, Rattanakosin et Ayutthaya dans l’architecture thaïlandaise #
Singularités architecturales du style Lanna #
Le style Lanna s’est développé autour de Chiang Mai, au sein du royaume du Million de Rizières, formant une tradition vernaculaire profondément ancrée dans le nord de la Thaïlande. Les structures y sont majoritairement basses, intégrant le bois comme matériau principal, une réponse directe à l’environnement forestier local et aux contraintes climatiques.
- Les toitures en tuiles surdimensionnées caractérisent les temples et maisons, optimisant l’évacuation des pluies abondantes et renforçant la présence visuelle du bâti dans le paysage montagneux.
- On retrouve des plans influencés par le monastère bouddhiste (viharn), intégrant des galeries ouvertes et des espaces semi-clos, favorisant la circulation de l’air et la ventilation naturelle.
- Le travail de la menuiserie atteint ici un raffinement exceptionnel : lambrequins, frontons et linteaux sont souvent ornés de motifs géométriques ou de représentations animalières stylisées.
La maison traditionnelle Lanna, bâtie sur pilotis, illustre une adaptation efficace aux crues et à la faune locale. On retrouve des exemples remarquables de ce type d’habitat à Ban Tawai ou au Musée des Maisons traditionnelles de Chiang Mai, où la disposition des pièces et la gestion de la lumière s’accordent intimement avec le cycle des saisons et la structure communautaire des villages.
Ce style architectural se distingue également par une esthétique sobre, où la décoration – bien que souvent complexe – reste intégrée à la structure porteuse et ne vise jamais l’ostentation. Cette sobriété confère aux édifices Lanna une harmonie particulière avec leur environnement naturel, une valeur de plus en plus recherchée dans le contexte actuel d’urbanisation rapide.
Influence des traditions d’Ayutthaya et du Rattanakosin sur le nord #
Le dialogue entre l’architecture Lanna et les apports venus des grandes capitales du centre, Ayutthaya puis Rattanakosin, a profondément modifié la physionomie du bâti dans le nord à partir du XVe siècle. L’introduction de la brique cuite et du stuc a permis la construction de temples et de chedis monumentaux, remplaçant ou complétant le bois traditionnel.
- La diffusion du plan axial, caractéristique d’Ayutthaya, a imposé des alignements plus rigoureux dans l’organisation des temples, visibles notamment à Wat Phra Singh ou Wat Chedi Luang.
- Les structures s’élèvent progressivement : on passe de toitures simples à des toitures superposées, accentuant la verticalité et le prestige spirituel des édifices religieux.
- L’apparition de motifs décoratifs sophistiqués (griffons, nâgas, lotus stylisés) empruntés aux palais royaux d’Ayutthaya et du Grand Palais de Bangkok de l’ère Rattanakosin, enrichit les surfaces des chedis et des viharns du nord.
Les interactions politiques, notamment à l’époque de Rama Ier de la dynastie Chakri, ont favorisé la circulation des artisans et des savoir-faire depuis la capitale. Ce mouvement s’est traduit par l’adoption de décors en stuc, de fresques murales racontant la vie du Bouddha, ou de toitures à multiples niveaux, signatures visuelles du style Rattanakosin comme on peut l’observer à Wat Phra Kaew, au cœur du quartier de Rattanakosin à Bangkok.
Des édifices majeurs tels que Wat Phra That Doi Suthep, dominant Chiang Mai depuis 1383, portent la trace de cette hybridation, où la monumentalité centrale dialogue avec les savoir-faire locaux. L’influence chinoise, introduite sous Rama III (1824-1851) par le biais du commerce et de la diplomatie, a ajouté des éléments tels que les tuiles vernissées ou les pavillons “keng chin”.
Le syncrétisme des styles dans les bâtiments religieux et civils #
Loin de se limiter à une cohabitation de formes, l’architecture thaïlandaise développe dès le XIXe siècle un syncrétisme stylistique audacieux. Cette tendance apparaît nettement dans les temples “hybrides” où colonnes sculptées Lanna, toitures superposées d’Ayutthaya et décors rattanakosins se combinent pour produire des œuvres originales.
- Le Wat Ton Kwen à Chiang Mai, exemplaire du style Lanna, intègre dans sa salle de prière des colonnes octogonales ornées de dorures, une toiture à trois niveaux et des éléments décoratifs issus de l’esthétique centrale.
- Dans l’habitat civil, la maison traditionnelle “khum” mélange pilotis, balcons fermés en bois, lucarnes décoratives et parfois même des pignons de style européen, héritage de la période coloniale et des influences occidentales du XIXe siècle.
- Le Musée des Maisons traditionnelles de Chiang Mai expose toute la richesse de cette hybridation, présentant des habitations où la distribution des pièces, le choix des matériaux et le traitement des espaces intérieurs témoignent d’une adaptation constante aux apports extérieurs.
À noter que la verticalité marquée de certains monuments (comme le chedi en forme de cloche du Wat Phra Kaew à Bangkok) dérive directement de l’architecture d’Ayutthaya. La présence de mondops, chofas dorés et mosaïques colorées dans des temples du nord signale, elle aussi, l’assimilation des canons Rattanakosin.
Nous observons que l’évolution des techniques de construction – de la charpente bois à la combinaison bois-maçonnerie – a permis d’accroître la durabilité et le prestige des édifices, tout en ouvrant la voie à une plus grande expressivité symbolique et narrative.
Évolution contemporaine : renaissance et adaptation des styles historiques #
À l’ère contemporaine, l’architecture thaïlandaise n’a jamais cessé de revisiter son patrimoine. Les architectes intègrent aujourd’hui les codes Lanna dans des projets d’hôtels, de résidences privées, mais aussi d’infrastructures culturelles ou éducatives.
- Le 137 Pillars House à Chiang Mai, ouvert en 2012, incarne une renaissance du style Lanna revisité aux standards du luxe contemporain, associant pilotis en teck, toitures traditionnelles et systèmes de climatisation passive.
- Des projets récents à Lampang et Phrae intègrent des matériaux locaux, tout en mixant la géométrie simple des maisons Lanna et les volumes monumentaux inspirés d’Ayutthaya ou du Rattanakosin.
- Dans le secteur hôtelier, Anantara Chiang Mai Resort propose des suites installées dans d’anciennes maisons de style colonial, enrichies de décors sculptés et de fresques inspirées des temples historiques.
Ce mouvement s’accompagne d’un souci accru pour la durabilité environnementale : usage de bois certifié, techniques de construction bioclimatique, récupération de matériaux anciens. L’adaptation du style passe aussi par la valorisation de l’espace extérieur, la multiplication des patios et l’insertion de jardins inspirés des monastères bouddhistes. La recherche de confort moderne cohabite ainsi avec la préservation de l’identité régionale. À l’international, des projets pilotés par le cabinet Interface Studio Architects ou le designer Duangrit Bunnag ont contribué à repenser l’architecture thaïlandaise à partir de ses racines hybrides, participant à la visibilité mondiale de cette esthétique.
Patrimoine vivant : préservation, transmission et valorisation culturelle #
La question de la conservation des architectures historiques reste au cœur des débats entre acteurs publics, ONG et communauté locale. L’engagement des institutions comme le Centre d’architecture du Lanna, fondé en 2010, structure une politique de sauvegarde exemplaire des maisons anciennes et des sites religieux emblématiques.
- De grands chantiers de restauration ont été conduits depuis 2008 sur le campus de l’Université de Chiang Mai et à Wat Chedi Luang, intégrant des équipes pluridisciplinaires alliant historiens, artisans menuisiers et architectes spécialisés.
- La transmission des savoir-faire s’appuie sur une nouvelle génération de maîtres charpentiers et de sculpteurs, diplômés de programmes soutenus par l’UNESCO (projet “Living Heritage” lancé en 2017).
- La valorisation touristique passe par la création de circuits patrimoniaux, l’ouverture de musées de site comme le Lanna Folklife Museum (inauguré en 2012), ainsi que des événements (ex : Lanna Expo à Chiang Mai, édition 2022) mettant à l’honneur la richesse du patrimoine bâti régional.
Nous notons une prise de conscience accrue, tant du côté des décideurs politiques que de la société civile, quant à la nécessité de concilier développement urbain et maintien de l’identité culturelle architecturale. La reconnaissance par l’UNESCO de certains ensembles, en projet depuis 2021, témoigne de la valeur universelle de cet héritage. L’articulation entre patrimoine vivant, revitalisation urbaine et création architecturale contemporaine participe à l’affirmation d’une “thaïté” plurielle, ouverte sur le monde.
Plan de l'article
- L’empreinte croisée des styles Lanna, Rattanakosin et Ayutthaya dans l’architecture thaïlandaise
- Singularités architecturales du style Lanna
- Influence des traditions d’Ayutthaya et du Rattanakosin sur le nord
- Le syncrétisme des styles dans les bâtiments religieux et civils
- Évolution contemporaine : renaissance et adaptation des styles historiques
- Patrimoine vivant : préservation, transmission et valorisation culturelle